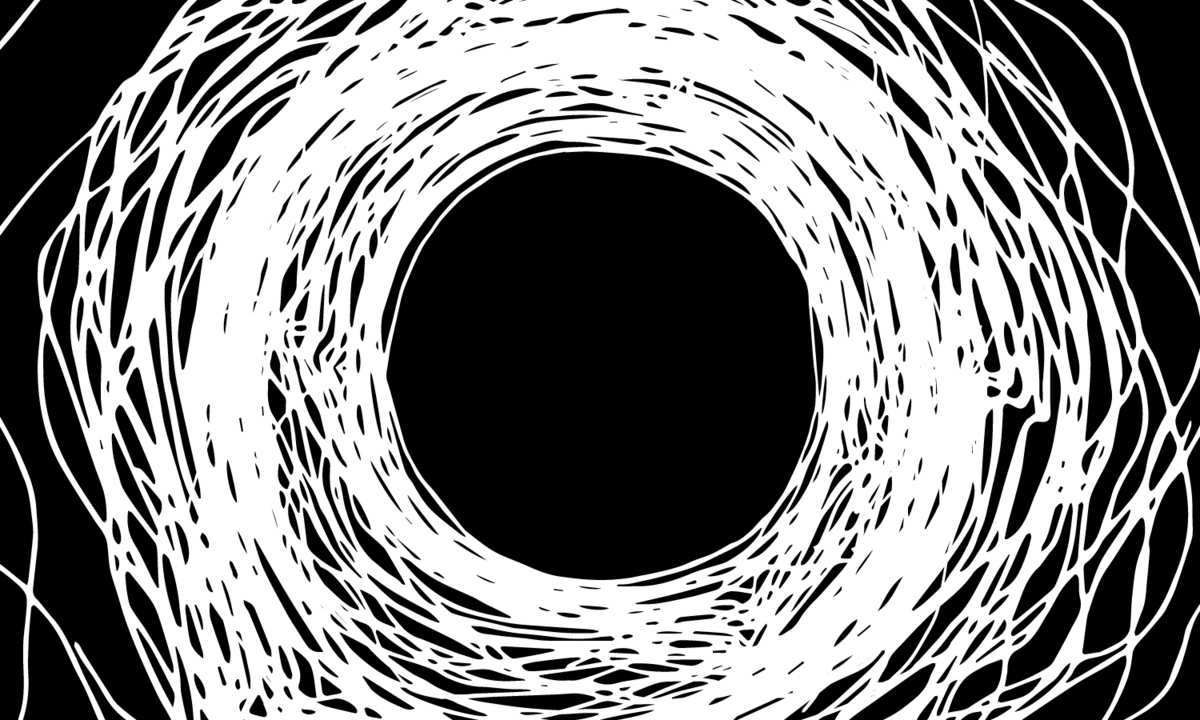La charge de police à l’origine des blessures de Geneviève Legay, le 23 mars 2019 à Nice, était disproportionnée, selon l’IGPN qui pointe la responsabilité du commissaire Rabah Souchi, à la tête des opérations. Un an et demi après les faits, le président Emmanuel Macron est donc démenti. Médaillé, en juin 2019, par le ministère de l’intérieur, Rabah Souchi est cependant toujours en poste.
Cette fois, l’Inspection générale de la police (IGPN) n’a pas pu faire autrement que de déclarer la charge des policiers disproportionnée. Et sa conclusion est éminemment symbolique dans une affaire qui a fait grand bruit, tant elle a été marquée par des mensonges, des dissimulations et des conflits d’intérêts. Selon les éléments réunis par Mediapart, l’IGPN reconnaît enfin ce que nombre de témoins se tuent à répéter depuis le début de l’affaire : Geneviève Legay, 73 ans, gravement blessée le 23 mars 2019, à Nice au cours d’une manifestation des « gilets jaunes » a bien été renversée par les forces de l’ordre au cours d’une charge que les gendarmes interrogés ont jugé brutale, violente et illégale.
Victime d’une hémorragie et de plusieurs fractures au crâne, l’état de santé de Geneviève Legay avait nécessité plus d’un mois de surveillance médicale.
Dans ses conclusions rendues en avril, l’IGPN met en cause le commissaire divisionnaire Rabah Souchi, à la tête des opérations et donne raison au capitaine de gendarmerie qui, le jour des faits, a refusé de participer à cette charge et d’engager son escadron composé de près de 60 hommes, comme nous l’avions révélé (à lire ici).
Une vidéo, tournée par la cellule image ordre public (CIOP) des gendarmes et jamais diffusée jusqu’à présent, montre la réalité de cette charge.
La gravité des faits a conduit ce capitaine à adresser à sa hiérarchie, le 25 mars 2019, deux jours après les faits, un rapport détaillé, que Mediapart révèle et publie dans son intégralité. Loin de s’inscrire dans le cadre d’une guerre police-gendarmerie, ce compte rendu, largement repris par l’IGPN dans ses conclusions, annihile ainsi le déni des autorités sur les violences policières. Dès le 23 mars, la haute hiérarchie de la gendarmerie avait d’ailleurs été alertée sur ces faits. Est-il possible que dans une affaire aussi médiatisée, des informations aussi sensibles ne soient pas remontées jusqu’à l’Élysée ?
Le 25 mars, Emmanuel Macron déclare pourtant dans les colonnes de Nice Matin : « Cette dame n’a pas été en contact avec les forces de l’ordre. » Et croit bon de préciser : « Quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. »
Le rapport de gendarmerie que nous publions aujourd’hui discrédite définitivement cette version.
Son auteur, le capitaine H. y qualifie la charge de « brutale et violente », en « totale disproportion et nécessité face à une foule d’une trentaine de personnes assez âgées, très calmes ».
Il alerte ses supérieurs sur le comportement du commissaire Rabah Souchi, « presque dangereux », qui « hurle » et ordonne de « triquer du manifestant », c’est-à-dire, de les battre à coups de bâton. Une situation inquiétante qui n’est pas sans rappeler les images montrant la militante pacifiste, allongée à même le sol, la tête ensanglantée, son drapeau arc-en-ciel à ses côtés et enjambée par des policiers casqués.
Selon l’IGPN, « les ordres donnés par le commissaire divisionnaire Souchi, ne se caractérisent pas un manque de clarté et un aspect directif ». Ils sont « inadaptés » en particulier « lors de la charge effectuée […] au cours de laquelle Madame Legay a été poussée ».
La stratégie proposée par les gendarmes, une vague de refoulement, au cours de laquelle les boucliers sont baissés et la force n’est pas employée, « aurait été une manœuvre d’une intensité proportionnelle à la situation ». Le vocabulaire alambiqué de l’IGPN est à la hauteur de son embarras. Pour autant, la police des polices ne peut ni soustraire le rapport de gendarmerie ni enterrer l’audition de son auteur, entendu dans le cadre de l’enquête judiciaire qui confirme le « non-respect de proportionnalité faisant suite à des sommations pas très claires ». En d’autres termes, l’illégalité de la charge.
L’IGPN rappelle, néanmoins, le contexte au moment des faits. Outre la venue le lendemain du président Emmanuel Macron et de son homologue chinois dans le département, le premier ministre souhaitait, en réponse à la mobilisation des gilets jaunes, « que soit mise en œuvre une stratégie renforcée par le recours de nouveaux outils », « l’utilisation de drones », « le recours aux hélicoptères dotés de caméras de haute précision », ou encore « la répression de la participation à une manifestation interdite », instituant, dispositif inédit, une contravention de 135 euros.
Les préfets établissent donc un arrêté portant sur l’interdiction de manifester sur un certain périmètre.
Pour autant, comme le relate auprès de l’IGPN le capitaine de gendarmerie, le jour de la mobilisation, à 7 h 45, « lors de la réunion de tous les responsables de police sur place et des chefs des commandants d’escadrons, un des commissaires présents a dit que les manifestations de gilets jaunes étaient calmes à Nice, sans casseur répertorié ».
« Il n’y a pas eu de consignes particulières pour cette manifestation », explique-t-il tout en précisant que « la volonté [du commissaire Rabah Souchi] à mon avis était d’interpeller le maximum de personnes ».
D’ailleurs, avant le début de la manifestation, alors que les escadrons de gendarmerie prennent position dans la ville, le commissaire Souchi annonce le ton de la journée. À l’une des lieutenantes, il « hurle que les gendarmes étaient là uniquement pour “triquer” du manifestant et sortir des véhicules uniquement pour “triquer” ». « Fortement choquée », elle a tenu à retranscrire ces propos auprès de sa hiérarchie.
À 10 h 30, le capitaine H. arrive sur la place Garibaldi, l’un des principaux points de rassemblements de la ville, interdit ce jour-là, et où près de 200 manifestants « présentant une physionomie tranquille et pacifique » commencent à se retrouver.
« Une fois sur les lieux, j’ai constaté que deux pelotons sécurisent une nasse avec à l’intérieur quelques gilets jaunes très calmes. » Le capitaine est chargé de former une seconde nasse, en d’autres termes d’encercler un autre groupe de manifestants présents et à les confiner, afin de procéder à des interpellations.
Auditionné par l’IGPN, le commissaire Souchi reconnaît lui-même que « les personnes qui se rassemblaient le faisaient dans le calme mais dans un périmètre interdit ». À ce moment-là, aucun ordre de disperser ne lui a été donné depuis la salle de commandement où était présent, notamment, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), Jean-François Illy.
Il envisage alors, selon l’IGPN, de mettre en place un contrôle en vue de faire évacuer et verbaliser les personnes présentes. Une pratique toute singulière, puisque « l’infraction de participation à une manifestation interdite […] n’existait pas deux jours avant », concède-t-il lui-même.
À 11 h 10, changement d’ambiance, selon le commissaire Souchi qui fait état « d’outrages » et qui reçoit l’ordre de dispersion du DDSP. « L’évolution de la situation qui a conduit à cette décision est que nous avons senti que la tension montait, et que les manifestants refusaient toute discussion. La décision du préfet répercutée par le DDSP vient du fait de l’existence de troubles à l’ordre public réels sur la place Garibaldi. »
Le capitaine H « précise surtout que la foule était calme auparavant et que suite à l’interpellation musclée d’un individu assez âgé qui est tombé au sol à plat ventre […] cela a fait réagir les manifestants ». Dans le compte-rendu adressé à sa hiérarchie, il précise que cette interpellation se fait « sans raison valable ».
Le commissaire Souchi ne s’embarrasse pas de cette chronologie : « Le groupe de manifestants formé dans la nasse que j’encadrais a effectivement invectivé les forces de l’ordre par des propos comme “police assassins” avec beaucoup de sifflets et rien de plus », rapporte le capitaine de gendarmerie.
Geneviève Legay est alors décrite comme « très excitée […] Elle tenait un drapeau arc-en-ciel […]. Je l’avais remarqué dans la nasse par son énervement. Elle invectivait un de mes gendarmes en disant qu’elle voulait sortir pour aller voir l’homme interpellé qui avait chuté. »
À 11 h 13, l’ordre de disperser est donné. Selon les gendarmes, « la physionomie était toujours calme ».
« Il m’a semblé que [les manifestants] étaient plus là pour faire valoir leur droit à manifester quitte à faire un peu de résistance passive mais l’attroupement à ce moment-là ne m’a pas semblé virulent », indique l’un d’entre eux auprès de l’IGPN.
Un policier rapporte également qu’ils « n’étaient pas agressifs physiquement. Ils n’ont pas lancé de projectiles ».
À 11 h 27, la foule est toujours paisible. Les premières sommations sont faites. Le commissaire Souchi « est arrivé sur moi, en hurlant et m’a ordonné de charger une foule calme dans la direction [d’une] zone également interdite à la manifestation ».
« Je me rends compte que nous refoulons les gens dans la mauvaise direction », raconte le capitaine H., une erreur du commissaire qui « ne se maîtrise plus ». Dans cette foule, Geneviève Legay agite son drapeau arc-en-ciel. « Elle déambulait normalement, dans la rue au milieu de ce groupe de manifestants », précise-t-il.
« Au regard de la foule qui est calme, T1 110 [le commissaire] continue de dire dans son mégaphone de charger et de gazer, son ordre me paraît disproportionné au regard du comportement de la foule. […] J’ai donc refusé de faire une charge. » Le capitaine ordonne alors à ses hommes de ne pas y participer.
Face à l’IGPN, il rappelle les fondamentaux de l’usage de la force : « Une charge implique l’usage des armes et donc des sommations à trois reprises sur l’usage de la force, ainsi qu’une situation le justifiant. Je précise que le fait de faire des sommations n’exonère pas du principe de nécessité et de proportionnalité. »
La police des polices demande au gendarme « en tant qu’observateur de la scène » de décrire la charge, réalisée finalement par les policiers de la Compagnie départementale d’intervention (CDI).
« Les policiers ont chargé immédiatement en courant […] Cela a duré quinze à vingt secondes tout au plus. Ils couraient à des vitesses différentes en venant au contact ou en percutant les personnes présentes. » Interrogé sur Geneviève Legay, le chef d’escadron ne peut « pas dire si elle a reçu un coup de matraque. Je pense qu’elle n’a pas eu le temps de réagir face à la rapidité de la charge ».
« Une vague de refoulement », c’est-à-dire, « en marchant, sans emploi de la force » aurait donc été plus adaptée, selon lui. Témoins de cette charge, « nous sommes tous abasourdis », lâche le capitaine H. Les gendarmes ont d’ailleurs pris soin de filmer le déroulement de l’ensemble des opérations, en particulier, la charge des policiers blessant Geneviève Legay.
Interrogé sur le choix de sa stratégie, le commissaire Rabah Souchi « tien[t] à dire qu’en la matière, il y a une obligation de résultat ». « La situation se tendait », il faisait face à des manifestants qui « chant[aient] La Marseillaise et refus[aient] de quitter les lieux », attitude qui justifie selon lui le recours à la force.
Catégorique, il affirme que cette manœuvre était, en toute logique, conforme à la situation, en rajoutant que, lorsqu’il a donné l’ordre de charger, il n’a pu « utiliser une fusée rouge, car nous étions en dessous des couloirs aériens ».
Ne se souvenant plus si des Tonfas ou des matraques avaient été utilisés, cette charge, dit-il, était « effectuée au pas de marche », malgré les vidéos qui contredisent formellement sa version.
Interrogé de nouveau par l’IGPN sur la nécessité d’une telle opération, il estime « qu’il appartient à celui qui s’expose de prendre en considération ces risques. On ne peut pas reprocher à un gardien d’un zoo qu’une personne se fasse mordre une main en passant celle-ci dans les barreaux d’une cage d’un animal dangereux » avant de conclure que selon lui, « l’avancée pédestre sans arme, c’est le niveau 0 d’une charge ». La proportionnalité de l’usage de la force semble être une considération fort éloignée des principes du commissaire.
Ainsi que le relate un autre capitaine auprès de l’IGPN, « il m’a dit de façon assez virulente : “Quand j’ai décidé de l’emploi de la force et que j’ai fait les sommations, quand je vous dis on disperse, c’est on disperse, tant pis pour les manifestants, on matraque, c’est le cadre légal. Ne faites pas comme votre homologue qui a refusé d’appliquer mes directives. Il s’en expliquera avec le préfet”. »
Malgré ces menaces, le gendarme explique avoir indiqué à M. Souchi « qu’il était hors de question de matraquer des gens qui n’étaient pas virulents et je lui rappelle que la réalisation des sommations ne nous exonère pas des principes de nécessité et de proportionnalité ».
« À aucun moment jusqu’à l’arrivée des secours, TI 110 [le commissaire Rabah Souchi – ndlr] ne s’est porté au niveau de la blessée pour prendre de ses nouvelles », écrit dans son rapport le capitaine de gendarmerie qui, après un énième comportement brutal du commissaire, « n’a qu’une hâte, c’est que tout cela s’arrête, car je commence franchement à réfléchir à me désengager […] après 3 heures 30 de galère. »
Quelques mois plus tard, le 16 juin 2019, ainsi que le révélait Mediapart, le ministre de l’intérieur Christophe Castaner récompensait le commissaire Rabah Souchi et sa compagne Hélène Pedoya. Cette promotion exceptionnelle de médaillés était officiellement nommée « gilets jaunes ».
Hélène Pedoya reste d’ailleurs la grande absente de l’enquête de l’IGPN qui, étrangement, a choisi de ne pas l’auditionner. Pourtant, cette commissaire divisionnaire en charge de l’enquête préliminaire sur l’origine des blessures de Geneviève Legay a également participé au maintien de l’ordre le jour des faits.
Lors de son audition, son compagnon, Rabah Souchi, le précise d’ailleurs sans que cela ne lui pose le moindre problème. Ainsi qu’il l’affirme, le jour des faits, aux alentours de 10 h 40, sur la place Garibaldi, il a fait venir « le commissaire Pedoya pour procéder à une seconde bulle », un encerclement bloquant une partie des manifestants. Moins d’une heure après, sur cette même place, la charge qu’il a ordonnée, blesse Geneviève Legay. Activement présente, la commissaire divisionnaire Hélène Pedoya ne s’est pourtant pas déportée de l’enquête qui lui a été confiée, le jour même, par le procureur de la République.
Elle a même, en orientant les premières investigations vers les journalistes présents à la manifestation, corroboré la version mensongère de son compagnon, Rabah Souchi. Ce dernier, dans son compte rendu des opérations du 23 mars à 22 h 48, attestait : « une chute en lien avec la présence d’un photographe s’accroupissant pour prendre un cliché des manifestants […] la manifestante [Geneviève Legay] trébuchait à ce moment-là. »
Ce conflit d’intérêts majeur qui a valu la mutation du procureur de la République de Nice (à lire ici) n’interpelle absolument pas l’IGPN.
« Nous attendons depuis maintenant trop longtemps que la juge d’instruction en charge de l’affaire tire les conclusions de son enquête, explique l’avocat de Geneviève Legay, Arié Alimi, auprès de Mediapart. À ce jour, elle a refusé au défenseur des droits l’accès au dossier. »
Concernant les commissaires divisionnaires Rabah Souchi et Hélène Pedoya, l’avocat déplore qu’ils ne soient « inquiétés ni par l’intérieur ni par la justice. Cela s’apparente désormais à de la protection forcenée ».
Que ce soit le ministère de l’intérieur qui s’était engagé à retirer les décorations en cas de manquement grave, la Direction générale de la police nationale (DGPN) au sujet d’éventuelles mesures disciplinaires, ou encore la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui n’a pas spontanément communiqué les éléments en sa possession à la justice : tous ont refusé de répondre aux questions de Mediapart.
- Les neuf dates-clés de l’affaire Geneviève Legay
© Mediapart


/image%2F1490620%2F20160113%2Fob_f72574_clap-blog.jpg)